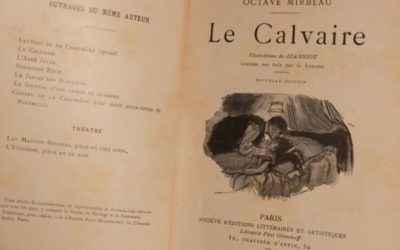Du calvaire à la rédemption
De 1880 à la fin de 1883, Octave Mirbeau a été la proie — consentante, semble-t-il — d’une dame de petite vertu à la cervelle d’oiseau, mais apparemment fort recherchée sur le marché de la galanterie, Judith Vinmer, qui lui a fait gravir les marches d’un crucifiant calvaire, jusqu’à ce qu’il fuie son douloureux esclavage, fin décembre 1883, et se réfugie au fin fond du Finistère, à Audierne (1). C’est là que, pendant sept mois, il va peu à peu s’efforcer de revenir à la vie, de reprendre pied parmi les hommes, de se remettre au travail et, progressivement, de se reconstruire. Il lui faudra encore mortifier sa chair au cours d’une randonnée, de Marlotte à Bourbon‑l’Archambault (2), en juillet 1884, avant de retrouver la capitale et ses miasmes morbides, et d’entamer sa rédemption.
Cette rédemption par le verbe va prendre deux formes : d’une part, il va se lancer dans ses grands combats pour la justice et pour la beauté (3) et ferrailler dans tous les grands quotidiens de l’époque au service des idéaux libertaires et humanistes qu’il a faits siens, après des années de prostitution journalistico-politique (4), et en faveur de la promotion des apporteurs de neuf, des talents et génies méconnus des arts (5) et des lettres (Monet, Rodin, Pissarro, Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Camille Claudel, Maillol, Maurice Maeterlinck, Léon Bloy, Marguerite Audoux etc.) ; d’autre part, il va enfin pouvoir voler de ses propres ailes et entamer, sous son nom, une carrière littéraire extrêmement tardive, pour cause de négritude (6). C’est en novembre 1885, soit à trente-sept ans et demi, qu’il publie, chez Laurent, sa première œuvre littéraire officielle, ses Lettres de ma chaumière, dont le titre révèle son intention de rivaliser avantageusement avec Alphonse Daudet et ses Lettres de mon moulin, accusées de donner de la vie une image édulcorée, à l’optimisme mensonger ; et c’est un an plus tard, fin novembre 1886, que paraît, chez Ollendorff, après une prépublication tronquée dans la Nouvelle revue de la « déroulédique » Juliette Adam (7), son premier roman assumé, Le Calvaire, qui connaîtra un grand succès (8) et suscitera un énorme scandale. Ce scandale est double. En premier lieu, comme il s’agit d’un roman-confession à la première personne et que le romancier s’inspire de sa liaison dévastatrice avec Judith pour faire le récit de « l’histoire » de Jean Mintié avec Juliette Roux, nombre de critiques, par pure malignité, et souvent pour se venger d’un pamphlétaire qui les a cruellement voués au ridicule qui tue, ont cru devoir assimiler l’auteur et le personnage et prêter à l’un les vilenies et bassesses de l’autre, lui reprochant de surcroît de se bâtir une réputation littéraire et une fortune, en espèces sonnantes, à la faveur du récit de ses propres turpitudes. Deuxième scandale, beaucoup plus grave encore : celui suscité, chez tous les braillards et soiffards du patriotisme, par le chapitre II du roman, où Mirbeau dénonce avec virulence les atrocités de l’armée française et, au moment même où la Revanche sacralisée est mise à l’ordre du jour par la République, ose s’en prendre à l’idée même de la Patrie, ce monstre assoiffé de sang qui précipite les frères humains dans d’inexpiables et absurdes boucheries. Cela vaudra au romancier d’être traité de toutes sortes de noms d’oiseaux et d’être considéré par maints pisse-copie comme stipendié par l’Allemagne… (9) Aujourd’hui que les deux guerres mondiales, et beaucoup d’autres sur toute la surface de la terre, semblent avoir porté, en France et en Europe occidentale, un coup qu’on espère décisif au bellicisme des nationalistes de tout poil, il est possible de jeter sur cette œuvre, souvent qualifiée à juste titre d’autobiographique, un regard plus distancié et moins partial, qui nous permet de mieux saisir ce qu’elle a de profondément original. Mirbeau y traite un sujet qui lui tient à cœur depuis longtemps. Dès 1868, en effet, il esquissait, pour son ami et confident Alfred Bansard des Bois, un « petit roman » intitulé Une Page de ma vie, qui, après une entrée en matière étonnamment désinvolte, et sans rapport apparent avec le sujet annoncé, devait, à l’en croire, donner lieu à « un récit d’amour tel qu’il a existé, avec toutes ses illusions, toutes ses voluptés, toutes ses larmes et toutes ses tortures. C’est l’éternelle histoire du cœur. Il n’y a rien de nouveau. Mais cet amour a pour moi d’autant plus d’attrait que le héros est un de mes amis, que j’avais perdu de vue, depuis mon départ de Caen, et que j’ai retrouvé à Paris il y a quelques jours. Lui que j’avais connu autrefois gai, spirituel, charmant, est aujourd’hui triste, désolé, et comme accablé sous le poids d’une immense douleur… Il n’a plus un sourire, plus une étincelle de vie. Il y avait en lui l’étoffe d’un grand artiste. Il avait rêvé une haute situation dans le monde des lettres et des arts. Il a brisé son violon, il n’écrit plus. Que va-t-il devenir ? Pauvre Albert (10) ! » Ce thème d’un être porteur de grandes espérances et détruit à petit feu par un amour dévastateur, c’est déjà le sujet du Calvaire, avant même que Mirbeau n’ait éprouvé dans son cœur et dans sa chair les ravages qu’il prêtera à son piètre héros. Mais lorsqu’en juillet 1885, il prend enfin la plume, dans le calme du Rouvray, près de Laigle, où il s’est réfugié (11) avec sa nouvelle compagne, l’ex-théâtreuse Alice Regnault (12), bien décidé à frapper un grand coup et à accéder d’emblée au premier rang des romanciers d’avenir, afin de faire oublier au plus vite ses années de prostitution, de domesticité et de négritude, ce n’est plus d’une simple fiction qu’il s’agit, rédigée avec le sang-froid de l’expérimentateur imaginé par Zola dans sa théorie du Roman expérimental : ce récit, c’est en effet de ses souvenirs les plus taraudants qu’il l’a nourri, et en le menant à son terme, il accomplit du même coup, non seulement un acte d’expiation, à l’instar du narrateur Jean Mintié, mais aussi un acte de libération. L’écriture constitue visiblement pour lui un exutoire et une thérapie. Si Mirbeau a pu se ressaisir et trouver sa voie, alors que son triste double s’est enfoncé sans espoir dans un abîme sans fond, où se sont pour un temps noyées ses potentialités créatrices, c’est bien parce qu’il n’a jamais cessé d’écrire et qu’il a fait de son désespoir et de sa honte mêmes la matière vivante d’un roman qui les transmuerait en œuvre d’art. Si autobiographiques que soient nombre d’épisodes du roman — par exemple, le meurtre du petit chien de Juliette ou le séjour finistérien —, il n’est pas question de réduire le romancier à son personnage : la médiocrité de l’un lui interdit pendant des années de se sauver, et il lui faudra descendre jusqu’au fond de l’abîme pour se libérer tardivement, alors que le génie de l’autre est sa planche de salut.
De surcroît, Mirbeau fait de la confession de son héros une arme dans le combat qu’il engage pour ouvrir les yeux de ses contemporains et les amener à prendre en horreur toutes les forces d’oppression — la famille, l’armée, l’Académie — et toutes les valeurs mystificatrices dont on berne le bon peuple, l’Amour aussi bien que la Patrie, histoire de parachever son abêtissement programmé et de s’assurer à bon compte de sa soumission. Dès lors il donne tardivement à sa vie un sens, une dignité et une valeur, que lui avaient fait perdre les louches compromissions auxquelles il a été condamné, pour gagner sa pitance quotidienne, pendant ses douze années d’un prolétariat pas comme les autres : celui de la plume.
On aurait tort, cependant, de trop s’arrêter à ces motivations toutes personnelles, au risque de négliger ce qui est peut-être, du point de vue de l’histoire littéraire, l’apport le plus important du Calvaire : la volonté manifestée par Mirbeau d’ouvrir une voie nouvelle, en évitant les deux impasses que sont, à ses yeux, le naturalisme et l’académisme. En mars 1885, dans une de ses Chroniques du Diable en forme de parabole, « Littérature infernale (13) », il opposait en effet et renvoyait dos à dos ces deux pôles du champ littéraire, aussi ennuyeux et aussi nauséeux l’un que l’autre, et également condamnés, pour cause d’absence totale de vie. Et il imaginait qu’un jour, dans un enfer de fantaisie en avance de quelques années sur la vie parisienne, « un jeune homme, un inconnu », écrirait « une œuvre simple, forte, passionnée, dans une belle langue forte, claire, vibrante » et en serait « puni par un succès formidable ». Ce jeune homme inconnu, qui, en réalité, n’est ni si jeune, ni si inconnu, ce sera évidemment Mirbeau lui-même ; et cette œuvre « passionnée », à la « belle langue claire, ce sera Le Calvaire… L’ambition du romancier est de sortir le roman des ornières où il se traîne lamentablement et de trouver, comme l’écrit le petit diable aux pieds fourchus, « un juste milieu entre Berquin et les peaux de lapin », entre une vision aseptisée et horriblement fadasse — celle d’André Theuriet et d’Octave Feuillet, surnommé « l’Octave des familles », par opposition à un autre Octave, beaucoup plus sulfureux… —, et une représentation du réel tout aussi conventionnelle et réductrice, puisqu’elle ne perçoit que le vernis superficiel des choses, et non leur mystère, les besoins physiologiques des hommes, et non leur âme : celle des naturalistes honnis.
De fait, d’entrée de jeu, il prend ostensiblement le contre-pied de la littérature conventionnelle et à l’eau de rose en nous offrant, de la société et de l’homme, une perception très noire, choquante pour le confort moral des lecteurs, bref démystificatrice en diable. Il s’emploie, ce faisant, à dessiller les yeux de ses lecteurs en leur révélant les choses telles qu’elles sont, dans leur horreur méduséenne, et non telles qu’on les a conditionnés à ne pas les voir. Les mythes sur lesquels repose le désordre social constituent autant de mensonges et de mystifications dangereuses, et notre imprécateur va s’employer avec jubilation à les faire apparaître au grand jour pour ce qu’ils sont : de dangereuses duperies.
Ainsi, dès son premier roman officiel, il démystifie et désacralise toutes les valeurs d’une société où tout marche à rebours du bon sens et de la justice, où les artistes de génie comme Lirat sont condamnés à l’incompréhension de critiques à œillères, aux ricanements d’un public moutonnier, et par conséquent à la misère, cependant que du gibier de potence accumule des fortunes mal acquises dans les tripots ou dans des trafics baptisés « affaires » (14), et que les Nana et les Juliette Roux se pavanent au Bois, admirées et applaudies par les ouvriers inconscients dont elles volent le pain, comme on le voit dans le dernier chapitre du roman. Plus précisément, Mirbeau démystifie la famille, dont « l’effroyable coup de pouce » déforme à tout jamais l’intelligence des enfants et détruit leur génie potentiel — thème développé de nouveau dans Sébastien Roch et Dans le ciel ; l’armée, dirigée par des traîne-sabres dépourvus de compétence et d’humanité, qui traitent leurs hommes comme du bétail conduit à l’abattoir, qui gaspillent criminellement les vies humaines et les ressources naturelles, et qui allient la cruauté et l’égoïsme à la plus insondable bêtise ; l’idée de patrie, au nom de laquelle, on l’a vu, on sacrifie les forces vives de la nation et on fait s’entretuer des hommes, qui, en temps de paix, auraient pu développer fraternellement leurs potentialités de bonheur et de création — comme Jean Mintié avec l’éclaireur prussien qu’il abat absurdement, en un geste réflexe qui préfigure celui de Meursault dans L’Étranger, lors même qu’il sentait en lui une âme de poète en communion avec la sienne ; le plaisir, que Mirbeau, après Baudelaire, compare à un fouet qui nous conduit inéluctablement « de tortures en supplices, du néant de la vie au néant de la mort (15) », et nous fait haleter comme d’effroyables damnés (16) ; et surtout l’amour, piège tendu par la nature aux desseins impénétrables, et qui ne nous est présenté que comme une effroyable torture.
Car l’amour dont il est question, dans Le Calvaire, ce n’est évidemment pas « l’amour frisé, pommadé, enrubanné », dont les fabricants de romans de salon font leurs choux gras, mais « l’amour barbouillé de sang, ivre de fange, l’amour aux fureurs onaniques, l’amour maudit, qui colle sur l’homme sa gueule en forme de ventouse, et lui dessèche les veines, lui pompe les moelles, lui décharne les os (17) ». Celui-là même que, créant un effet d’abyme, ne cesse de peindre Lirat, dans des toiles qui ressemblent comme deux jumelles à celles de Félicien Rops, le peintre belge ami de Baudelaire que le romancier fréquente assidument depuis un an. Le destin de Jean Mintié apportera une confirmation expérimentale à cette analyse d’un pessimisme noir, déjà illustrée par L’Écuyère et La Belle Madame Le Vassart, deux de ses romans “nègres”.
S’il tourne un dos méprisant à la littérature bien-pensante, Octave Mirbeau ne se rallie pas pour attirant à l’alternative du naturalisme. Certes, si, comme tant de lecteurs de l’époque et de la nôtre, on parcourt paresseusement et superficiellement le roman, on pourrait être tenté de qualifuer de “naturalistes” cette vision très pessimiste de l’homme, marquée au coin du schopenhauerisme, et cette critique radicale, potentiellement anarchisante, de la société bourgeoise. Et, de fait, un certain nombre des thèmes que traite Mirbeau apparaissent aussi, à la même époque, chez Guy de Maupassant, Émile Zola, Alphonse Daudet, Henry Céard ou Edmond de Goncourt. Mais en réalité, les influences prédominantes sont celles de Barbey d’Aurevilly (à qui Mirbeau emprunte sa conception de l’amour et dont il partage le goût du paroxysme), d’Edgar Poe (18) (création d’une atmosphère de mystère et de terreur, importance des hallucinations, démon de la perversité), de Dostoïevski (plongée dans les abîmes de l’inconscient, mise en œuvre d’une psychologie des profondeurs), et de Léon Tolstoï, qui sera désormais son maître spirituel (“pitié douloureuse » pour les souffrants de ce monde, refuge au sein de la nature rédemptrice). Et le romancier prend bien soin de se démarquer du modèle naturaliste :
• En premier lieu, il refuse toute objectivité. Rédigé à la première personne, le récit est en effet totalement subjectif : les événements, les personnages, les paysages, tout est réfracté à travers une conscience qui trie, qui sélectionne, qui déforme, voire qui transfigure toutes choses. Le romancier ne nous livre qu’une « représentation » — au sens de Schopenhauer — du monde, qui est perçu à travers le prisme déformant de la sensibilité maladive du personnage-narrateur, sans aucun moyen pour le lecteur — comme dans certains contes fantastiques d’Edgar Poe — d’en connaître le degré de conformité à une « réalité » supposée objective. Souvent, en lieu et place d’une évocation “réaliste » des événements et des êtres, on a droit à des « rêves », à des « visions », à du « délire », voire à des « hallucinations », c’est-à-dire à des états de conscience qui, au lieu de nous révéler les choses telles que les observerait à froid le romancier rêvé par Zola, créent une atmosphère de fièvre et de cauchemar à la manière de Dostoïevski, notamment dans Crime et châtiment, que Mirbeau vient de découvrir (19). Le Calvaire, publié quelques mois seulement avant Les Lauriers sont coupés, d’Édouard Dujardin, peut ainsi être considéré comme l’une des toutes premières expériences de monologue intérieur.
• En deuxième lieu, alors que Zola pose solidement la charpente de ses romans et les structure avec le plus grand soin, Mirbeau ne s’est aucunement soucié de composer, comme il l’avoue à Paul Bourget, qui est alors som ami : « En écrivant, je ne me suis préoccupé ni d’art, ni de littérature, […] je me suis volontairement éloigné de tout ce qui pouvait ressembler à une œuvre composée, combinée, écrite littérairement. J’ai voulu seulement évoquer une douleur telle quelle, sans arrangement ni drame (20) ». Cet abandon du modèle balzacien et zolien de romans bien composés est révélateur du souci de transcrire le plus fidèlement possible une expérience vécue, sans « arrangement » préalable qui la dénaturerait, sans tentative arbitraire pour la faire entrer de force dans un cadre préétabli : ce n’est pas de la « littérature », avec tout ce que ce mot connote d’artifice, c’est de la vie. Il exprime aussi le refus de tout finalisme : alors que le roman balzacien et post-balzacien, par le souci de la construction et du déterminisme régissant les personnages, donne inévitablement au récit une allure finaliste, puisque tout est voulu et organisé par le romancier, qui apparaît comme le substitut de Dieu (rappelons que Balzac voulait faire concurrence à l’état-civil, donc à Dieu, et qu’il a baptisé l’ensemble de son œuvre de fiction Comédie humaine, par référence à la Divine comédie), ici rien de tel, l’évocation chaotique et discontinue des événements, dans le désordre des impressions et des souvenirs, sauvegardant leur caractère contingent.
• En troisième lieu, Mirbeau préserve soigneusement le mystère des êtres et des choses. Au rebours du scientiste Émile Zola, qui souhaitait tout expliquer et tout ramener à des lois simples, et qui prétendait absurdement appliquer au roman, récit fictif, la méthode expérimentale élaborée par Claude Bernard à l’usage de la médecine, Mirbeau, sous l’influence conjuguée de Pascal, de Schopenhauer et d’Herbert Spencer, ne pense pas du tout qu’il soit possible d’accéder à une « vérité ultime ». Ayant l’impression de se heurter partout à de « l’inconnaissable », il se refuse à mutiler l’infinie richesse de la vie obscure des âmes en la soumettant au lit de Procuste d’une clarté prétendument scientifique et beaucoup trop commode pour ne pas être suspecte. C’est pourquoi il s’arrange pour que Juliette Roux soit toujours perçue de l’extérieur, à travers le regard de Jean Mintié. Or il se trouve que ce personnage-narrateur est égaré par l’amour, puis par la jalousie ; qu’il est un névrosé, souvent malade et souffrant de surcroît de véritables hallucinations ; et qu’il écrit de longues années après les faits, au risque de nous livrer après coup une reconstitution suspecte, non seulement d’oublis et d’erreurs involontaires, mais aussi d’insincérité. On n’a donc aucune garantie de la véracité des faits qu’il rapporte, ni de la justesse des interprétations qu’il en donne. On ne sait pas, et on n’a aucun moyen de savoir avec certitude, quelle est, chez Juliette, la part de sadisme, conforme au mythe de la femme fatale et de la vamp véhiculé par toute une littérature fin-de-siècle étudiée par Mario Praz ; celle de l’inconscience d’un être futile et infantile, victime dans sa jeunesse d’une tentative de viol par inceste qui expliquerait ses perturbations psychiques ; celle de la prédatrice sans scrupules avide de millions avant toutes choses ; celle de « la nécessité», douloureusement assumée, de louer son corps pour assurer sa pitance quotidienne ; et celle de ce qu’il est convenu d’appeler « l’amour », le « sentiment » qui la lie à Mintié. On est donc parfaitement en droit de faire siennes diverses interprétations, qui, même extrêmes, ne sont pas incompatibles pour autant : il est, par exemple, tout aussi légitime d’imaginer qu’à sa façon elle « aime » sincèrement Jean Mintié, tout en participant volens nolens à sa déchéance, que de voir en elle une nouvelle Lilith « tout entière à sa proie attachée » et qui prend plaisir à torturer ses proies avant de les dévorer, à l’instar de la mante religieuse. Chaque lecteur est libre de procéder aux combinaisons et aux dosages qu’il voudra, sans qu’aucune autorité lui impose une « vérité » intangible. Quant à Jean Mintié, malgré ses efforts pour nous faire partager ses impressions vécues, lors des quelques temps forts de son existence, il est, à lui-même aussi, une énigme indéchiffrable ; et le romancier se contente en général de décrire ce que ressent son personnage, si incompréhensible que cela puisse paraître à nombre de lecteurs qui n’ont jamais rien connu de tel, sans essayer de recourir aux analyses psychologiques à la façon de Paul Bourget, armé de son dérisoire « scalpel », ou de réduire la psychologie à la physiologie, comme a tendance à le faire (et à le théoriser) Émile Zola.
• En quatrième lieu, Mirbeau fait preuve d’une étonnante modernité en manifestant à l’égard de la littérature, en ce qu’elle a d’artificiel, un mépris dont témoigne sa désinvolture, en totale rupture avec le sérieux affecté par Zola et ses disciples. Par exemple, il laisse subsister dans la vie de son héros un trou de cinq ans, et ne le comble que très partiellement par un bref retour en arrière au cours du chapitre III ; il ne se soucie même pas de préciser d’où nous parvient son récit, qui n’est donc pas justifié, ni à qui il est destiné (on ne saura pas qui est désigné par ce « vous » employé à six reprises) ; et il termine abruptement son roman, sans expliquer ce que devient son héros halluciné déguisé en ouvrier. On sait, par les lettres de Mirbeau à son confident Paul Hervieu, que cette désinvolture finale, qui laisse le récit ouvert, est à l’origine due à l’impossibilité de caser, dans un volume au format préalablement fixé par contrat, les développements initialement prévus : la reconquête de Jean Mintié par la nature apaisante et sanctifiante, qu’il en est donc réduit à réserver pour une suite, jamais écrite, qui se serait appelée La Rédemption. Mais en se soumettant à ce format qui ampute son roman de moitié et laisse la vie du héros se poursuivre sans lui, le romancier révèle son refus de tout cadrage préétabli dans lequel, au mépris de la vérité et de la vie, on prétendrait faire entrer de force toute la matière romanesque. Il est bien en cela le frère spirituel des peintres impressionnistes, dont il sera le chantre attitré.
Pour autant Mirbeau n’a pas encore, tant s’en faut, rompu complètement avec les règles et les traditions romanesques en vigueur au XIXe siècle. Tout se passe comme s’il avait craint de prendre trop de risques à chambarder trop brutalement les habitudes culturelles de son lectorat. Ainsi, les deux premiers chapitres, consacrés à l’enfance du narrateur et à son expérience traumatisante de la guerre de 1870 ne sont pas du tout des hors-d’œuvre, comme le lui ont reproché des critiques mal avisés ou mal intentionnés, mais ont pour fonction d’expliquer bien sagement, conformément à un déterminisme de bon aloi, la veulerie du « héros » pris dans les rets de Juliette Roux : l’hérédité pathologique, l’influence délétère du milieu petit-bourgeois de province, et le traumatisme de la débâcle, conjuguent leurs effets pour faire de Jean Mintié un velléitaire, qui témoigne du malaise de toute une génération, en même temps qu’il sert de révélateur de la dégénérescence de toute une classe sociale. Bref, même si Mirbeau a entendu exprimer, d’une façon délibérément impressionniste, une expérience individuelle et irréductible, elle n’en a pas moins une portée générale et contribue à la compréhension de toute une époque. Et c’est précisément ce qui en fait la richesse. De même, tout en respectant la technique du point de vue, qui implique que le narrateur ne sache pas tout, le romancier n’en fournit pas moins à ses lecteurs quantité d’éléments explicatifs de nature à satisfaire un tant soit peu leurs exigences d’intelligibilité. Il recourt aussi à la convention du style indirect libre pour évoquer et rendre compréhensibles les débats intérieurs qui agitent son personnage. Tout cela contribue à réduire l’effet d’étrangeté du récit, qui a davantage choqué par la subversion des valeurs morales et politiques que par ses audaces littéraires, pourtant bien réelles.
Enfin, même si, on l’a vu, il s’enracine dans sa propre expérience, qui n’est réductible à aucune autre, le sujet n’est pas neuf pour autant et s’inscrit dans une triple tradition romanesque : celle de « l’histoire », c’est-à-dire un bref roman d’amour à deux personnages principaux, et qui finit mal (par ex., Manon Lescaut ou Fanny, d’Ernest Feydeau) ; celle du « collage », inaugurée par Champfleury avec Les Aventures de Mademoiselle Mariette, et qui vient d’être illustrée avec éclat par Daudet dans sa Sapho (1884) ; et surtout celle de la « femme fatale », de la vamp sans cœur, qui possède, domine, torture et détruit l’homme, comme Mirbeau l’a affirmé dans un stupéfiant article de 1892 sur la Lilith, de Remy de Gourmont (21) (ainsi en est-il de la Foedora de La Peau de chagrin de Balzac, ou de la Clara du Jardin des supplices). Si originalité de l’œuvre il y a bien, malgré tout, c’est beaucoup moins par le sujet que par la façon de le renouveler : par l’étonnant mélange de frénésie et de lucidité, qui « atteste d’une manière si effrayante la complexité de notre nature », comme l’écrit Paul Bourget dans son compte rendu du roman (22) ; par la rupture avec la psychologie à la française ; et par la portée existentielle du récit, où, par-delà la critique sociale, le romancier nous fait partager sa conception tragique de l’humaine condition.
Grâce au triomphe de ce premier roman avoué et au scandale qu’il a suscité, Mirbeau a d’emblée pris place au premier rang de ceux qui entendent déboulonner la vieille littérature (23) et frayer, dans le roman, des voies originales. La suite de son œuvre confirmera éloquemment les promesses de ce premier chef‑d’œuvre.
Pierre Michel, préface du Calvaire, Éditions du Boucher
Notes de bas de page :
1 Sur cet épisode de la vie du romancier, voir les chapitres VII et VIII de notre biographie de L’Imprécateur au cœur fidèle, Séguier, 1990.
2 Voir le récit qu’il en fait dans Sac au dos, édité par P. Michel et J.-F. Nivet, L’Échoppe, 1991.
3 Voir ses Combats politiques, Séguier, 1990, ses Combats pour l’enfant, Ivan Davy, 1990, ses articles sur L’Affaire Dreyfus, Séguier, 1991, ses Combats esthétiques, Séguier, 1993 (2 volumes), ses Chroniques musicales, Séguier 2001, et ses Combats littéraires, Éd., Lausanne, L’Âge d’homme / Angers, Société Octave Mirbeau, 2006. Tous ces volumes ont été publiés par P. Michel et J.-F. Nivet (sauf Combats pour l’enfant, édité par P. Michel seul).
4 Voir la deuxième partie de notre biographie d’Octave Mirbeau.
5 Il a déjà entamé ses combats esthétiques sous divers pseudonymes. Voir les articles que j’ai recueillis dans ses Premières chroniques esthétiques, Société Octave Mirbeau / Presses de l’Université d’Angers, 1996.
6 Sur ces années de négritude, voir mon article « Quand Mirbeau faisait le nègre », dans les Actes du Colloque Octave Mirbeau du Prieuré Saint-Michel, Éd. du Demi-Cercle, 1994, pp. 80–112, et mes introductions aux romans “nègres” mis en ligne par les Éditions du Boucher : L’Écuyère, La Maréchale, La Belle Madame Le Vassart, Dans la vieille rue et La Princesse Ghislaine.
7 « La mère Adam », comme il l’appelle, lui a imposé de couper le chapitre II, de nature à désespérer les lecteurs de sa revancharde revue par le spectacle de la débâcle et des hontes de l’armée française… Connaissant la donzelle, il est très étonnant que Mirbeau ait songé à lui proposer son roman. Sans doute la perspective d’encaisser les trois mille francs qui lui étaient proposés et de toucher un vaste réseau de lecteurs l’a‑t-elle incité à passer par-dessus l’abîme qui le séparait de celle qu’il appelait ironiquement « Mme Hervé (de la Moselle) » dans L’Écuyère.
8 En quelques jours, les huit premières éditions du Calvaire sont épuisées, et une trentaine d’autres vont suivre.
9 Après avoir laissé passer l’orage, Mirbeau s’est décidé, dès le 8 décembre dans Le Figaro, à moucher d’importance ses diffamateurs dans ce qui constituera la préface à la neuvième édition du Calvaire (reproduite dans cette édition).
10 Lettres à Alfred Bansard des Bois, Éditions du Limon, Montpellier, 1989, p. 113.
11 Il fuit les ragots parisiens sur sa liaison avec Alice Regnault, mise en cause lors du premier acte de l’affaire Gyp (elle est accusée d’avoir voulu vitrioler la comtesse de Martel, qui signe Gyp ses romans légers). Elle a bénéficié d’un non- lieu, mais l’affaire rebondit le 20 juin 1885 et vient relancer Octave et Alice au Rouvray : dans un roman à clefs et à scandale, Le Druide, qui paraît ce jour-là, Gyp se venge d’Alice, en l’accusant notamment d’avoir empoisonné son premier mari, et vitupère Mirbeau, reconnaissable sous le masque du pamphlétaire Daton. Peu après, elle accusera Mirbeau d’avoir voulu la revolvériser… Sur cette sombre « affaire Gyp », voir mon article dans Littératures, Toulouse, n° 26, 1992, pp. 209–220.
12 Sur Alice, voir Pierre Michel, Alice Regnault, épouse Mirbeau, À l’écart, Reims, 1993.
13 Dans L’Événement du 22 mars 1885 (recueilli par nos soins dans le n° 1 des Cahiers Octave Mirbeau, printemps 1994, pp. 151–156). Voir notre édition des Chroniques du Diable, Annales littéraires de l’Université de Besançon, 1995 (volume disponible auprès de la Société Octave Mirbeau).
14 Mirbeau reviendra sur cette dénonciation du gangstérisme des affaires dans son chef‑d’œuvre théâtral, créé à la Comédie-Française en avril 1903, Les affaires sont les affaires (édition critique réalisée par mes soins, parue en 2003, dans le tome II du Théâtre complet de Mirbeau, nouvelle édition corrigée et complétée, chez Eurédit, Cazaubon).
15 « Un Crime d’amour », Le Gaulois, 11 février 1886 (article signé Henry Lys).
16 Voir surtout l’évocation des toiles de Lirat, au chapitre III, et l’hallucinante danse macabre des dernières lignes. Dans plusieurs chroniques de l’époque, Mirbeau s’emploie à souligner le caractère mortifère du plaisir. Voir aussi ses Petits poèmes parisiens de 1882, publiés par mes soins en 1994 aux Éditions À l’écart, Reims (notamment « Le Bal des canotiers»).
17 Le Calvaire, chapitre III. 18 Un des premiers essais littéraires signés de son nom, en 1882, était précisément un pastiche d’Edgar Poe : « La Chanson de Carmen » (il est recueilli dans notre édition des Contes cruels de Mirbeau, Les Belles Lettres, 2000, tome II, pp. 259–265).
19 Sur l’influence de Dostoïevski, voir l’article de Pierre Michel, « Octave Mirbeau et la Russie », dans les Actes du colloque Vents d’Ouest en Europe, souffles d’Europe en Ouest, Presses de l’Université d’Angers, pp. 468–471.
20 Lettre à Paul Bourget du 21 novembre 1886 (recueillie dans le premier volume de la Correspondance générale, L’Âge d’Homme, décembre 2002).
21« Lilith », Le Journal, 20 novembre 1892 (article signé Jean Maure).
22 Paul Bourget, Nouvelle Revue, janvier 1887, p. 140.
23 . Comme l’écrit Paul Hervieu à son ami : « Vous rentrez par la grande porte du succès. Votre roman est un des plus beaux et le plus fort cri d’humanité. Le Calvaire vous vaudra un succès ».
La puissance du mystère féminin dans Le calvaire
En tant que premier roman Le Calvaire révèle les principaux thèmes de toute l’œuvre d’Octave Mirbeau, et la femme se place véritablement parmi les plus obsédants et les plus fascinants …
Sébastien Roch (1890)
Dans ce troisième roman signé de son nom, Mirbeau transgresse un tabou majeur : celui du viol d’adolescents par des prêtres, sujet dont on n’a commencé à parler qu’un siècle après sa publication.
L’abbé Jules (1888)
L’Abbé Jules est un roman français d’Octave Mirbeau, publié chez Charpentier le 13 mars 1888, après une prépublication en feuilleton dans le Gil Blas. Évocation d’un prêtre
Le Calvaire (1886)
Le héros, Jean-François-Marie Mintié, raconte son enfance désenchantée et son adolescence solitaire, l’expérience amère de la guerre de 1870, dans les mobiles de l’armée de la Loire, puis le « calvaire » que lui a fait gravir sa maitresse, Juliette Roux, femme de petite vertu à laquelle l’attache un amour dévastateur face auquel la lucidité s’avère impuissante.