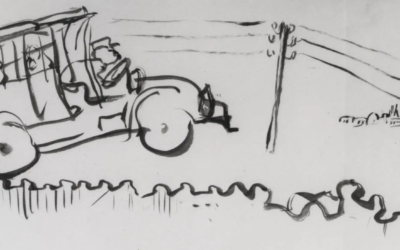Le journal d’une femme de chambre (1900)
La première mouture du roman a paru en feuilleton dans L’Écho de Paris, du 20 octobre 1891 au 26 avril 1892. Mirbeau traverse alors une grave crise morale et conjugale, se sent frappé d’impuissance et se dit dégoûté de la forme romanesque en général et de son feuilleton en particulier. Aussi attendra-t-il presque neuf ans avant de publier son roman en volume, en juillet 1900, après l’avoir complètement remanié, et avoir situé le récit pendant l’affaire Dreyfus, dont il sort plus que jamais dégoûté des hommes.
Mise à nu des turpitudes sociales
Le journal de Célestine est d’abord une belle entreprise de démolition et de démystification. Mirbeau y donne la parole à une chambrière, ce qui est déjà subversif en soi. Elle perçoit le monde par le trou de la serrure et ne laisse rien échapper des « bosses morales » de ses maîtres. Il fait de nous des voyeurs autorisés à pénétrer au cœur de la réalité cachée de la société, dans les arrière-boutiques des nantis, dans les coulisses du théâtre du « beau monde ». Il arrache le masque de respectabilité des puissants, fouille dans leur linge sale, débusque les crapuleries camouflées derrière les manières et les grimaces avantageuses. Et il nous amène peu à peu à faire nôtre le constat vengeur de Célestine : « Si infâmes que soient les canailles, ils ne le sont jamais autant que les honnêtes gens ». Bref, il nous révèle l’envers du décor et le fonds de sanie du cœur humain, mis à nu sans souci de la pudeur, qui n’est jamais que le cache-sexe de l’hypocrisie. Il réalise ainsi l’objectif qu’il s’était fixé dès 1877 : obliger la société à « regarder Méduse en face » et à prendre « horreur d’elle-même ».
Le roman est donc conçu comme une exploration pédagogique de l’enfer social, où règne la loi du plus fort : le darwinisme social triomphant n’est jamais que la perpétuation de la loi de la jungle sous des formes à peine moins brutales, mais infiniment plus hypocrites. Le « talon de fer » des riches, comme disait Jack London, écrase sans pitié la masse amorphe des exploités, corvéables à merci, qui n’ont pas d’autre droit que de se taire et de se laisser sucer le sang sans récriminer, sous peine d’« anarchie » – comme le déclare le commissaire auprès duquel Célestine va porter plainte pour n’avoir pas perçu le salaire qui lui est dû.
Loin d’être les meilleurs, comme le proclament les darwiniens, les prédateurs nous donnent le piteux exemple d’êtres qui ne se définissent que négativement, par l’absence de sensibilité, d’émotion esthétique, de conscience morale, de spiritualité et d’esprit critique. Après Flaubert et Baudelaire, Mirbeau fait du bourgeois l’incarnation de la laideur morale, de la bassesse intellectuelle et de la misère affective et sexuelle, dont les Lanlaire, au patronyme ridicule, sont les vivants prototypes.
Une œuvre de justice sociale
L’une des turpitudes les plus révoltantes de la société bourgeoise est la domesticité, forme moderne de l’esclavage :
« On prétend qu’il n’y a plus d’esclavage… Ah ! voilà une bonne blague, par exemple… Et les domestiques, que sont-ils donc, sinon des esclaves ?… Esclaves de fait, avec tout ce que l’esclavage comporte de vileté morale, d’inévitable corruption, de révolte engendreuse de haines ».
- Et les trafiquants d’esclaves modernes, ce sont ces officines scandaleuses, mais légales, que sont les bureaux de placement, relayés par des sociétés prétendument « charitables » ou « philanthropiques », qui, au nom de Dieu ou de l’amour du prochain, s’engraissent impunément de la sueur et du sang des nouveaux serfs.
- Le domestique est un être déclassé et « disparate », « un monstrueux hybride humain », qui « n’est plus du peuple, d’où il sort », sans être pour autant « de la bourgeoisie où il vit et où il tend ».
- L’instabilité est son lot : les femmes de chambre sont ballottées de place en place, au gré des caprices des maîtres.
- Elles sont surexploitées économiquement.
- Elles sont traitées comme des travailleuses sexuelles à domicile – exutoires pour les maris frustrés, initiatrices pour les fils à déniaiser ou à retenir à la maison.
- Elles sont humiliées à tout propos par des maîtres à l’inébranlable bonne conscience, qui traitent leur valetaille comme du cheptel.
- Elles sont aliénées idéologiquement par leurs employeurs, et, partant, incapables de se battre à armes égales, parce que hors d’état de trouver une nourriture intellectuelle qui leur laisse un espoir de révolte et d’émancipation.
Aussi Mirbeau entend-il à la fois aider les opprimé(e)s à prendre conscience de leur misérable condition et susciter dans l’opinion publique un scandale tel qu’il oblige les gouvernants à intervenir pour mettre un terme à cette honte permanente. En nous obligeant à découvrir l’abus sous la règle, et, sous le vernis des apparences, des horreurs sociales insoupçonnées, il exprime sa pitié douloureuse pour « les misérables et les souffrants de ce monde » auxquels il a « donné son cœur », comme le lui écrit Zola.
La nausée
Ce dégoût et cette révolte contre un ordre social inhumain s’enracinent dans un écœurement existentiel qui perdure ; et la pourriture morale des classes dominantes reflète la pourriture universelle, d’où germe toute vie. « Il s’exhale du Journal d’une femme de chambre une âcre odeur de décomposition des chairs et de corruption des âmes, qui place l’œuvre sous le signe de la mort », écrit Serge Duret ; « la loi de l’entropie règne sur les corps » – et sur les âmes. Ici, le tragique de l’humaine condition sourd à tout instant de l’évocation de la quotidienneté dans tout ce qu’elle a de vide, de vulgaire et de sordide. “L’ennui” dont souffre Célestine, c’est « l’expérience du vide » évoquée par André Comte-Sponville. Bien avant Sartre, Mirbeau s’emploie à susciter chez nous une véritable « nausée existentielle ».
La thérapie par l’écriture
Pourtant, si étouffante et morbide que soit l’atmosphère, si décourageante que soit la perspective d’une humanité vouée sans rémission au pourrissement et au néant, une fois de plus, l’écriture-supplice se mue en délicieuse thérapie. Nouvelle illustration de la dialectique universelle : ce qui devrait être source d’écœurement se révèle tonique et jubilatoire ; de l’exhibition de nos tares naît un amusement contagieux ; du fond du désespoir s’affirme la volonté d’un mieux qui aide à supporter moins douloureusement une existence absurde ; la nausée n’est que la première étape indispensable à l’« élévation » et à l’engagement social ; et Mirbeau ne nous enfonce, pédagogiquement, la tête dans la boue, la « charogne » et les « miasmes morbides », que pour mieux nous inciter, comme Baudelaire, à chercher ailleurs une sérénité, voire un épanouissement spirituel.
Pierre Michel pour la S.O.M.
Le jardin des supplices (1899)
Ce roman, publié en 1899, au plus fort de l’affaire Dreyfus, à la veille du procès d’Alfred Dreyfus à Rennes, est le point d’orgue d’un long combat contre la société capitaliste. Le Jardin des supplices est d’abord un texte de combat dont les trois parties…
Dingo (1913)
La fable, illustrant les apories du naturisme, fait bon ménage avec la caricature, et les plus burlesques hénaurmités ont droit de cité. De nouveau, ce n’est pas un homme qui est le héros du “roman”, mais le propre chien de Mirbeau, Dingo …
La 628-E8 (1907)
Dédiée à Fernand Charron, le constructeur de l’automobile « Charron 628-E8 », cette œuvre inclassable n’est ni un véritable roman, ni un reportage, ni même un récit de voyage digne de ce nom, dans la mesure où le romancier-narrateur n’a aucune prétention à la vérité…
Les 21 jours d’un neurasthénique (1901)
Comme Le Jardin des supplices, ce volume résulte d’un bricolage de textes : Mirbeau juxtapose quelque 55 contes cruels parus dans la presse entre 1887 et 1901, sans se soucier de camoufler les…
Dans le ciel (1892)
Dans le ciel est un roman paru en feuilleton dans les colonnes de L’Écho de Paris du 20 septembre 1892 au 2 mai 1893 et qui n’a été publié en volume qu’en 1989, aux Éditions de l’Échoppe, Caen,…
Perspectives sadiennes dans Le Jardin des supplices
Avec Octave Mirbeau, nous entrons de plain-pied dans le domaine du sacré profanatoire, entendu au sens bataillien, c’est-à-dire sacré de transgression. Il ne s’agit…